Jean D’Ormesson : Un chant éternel d’espérance
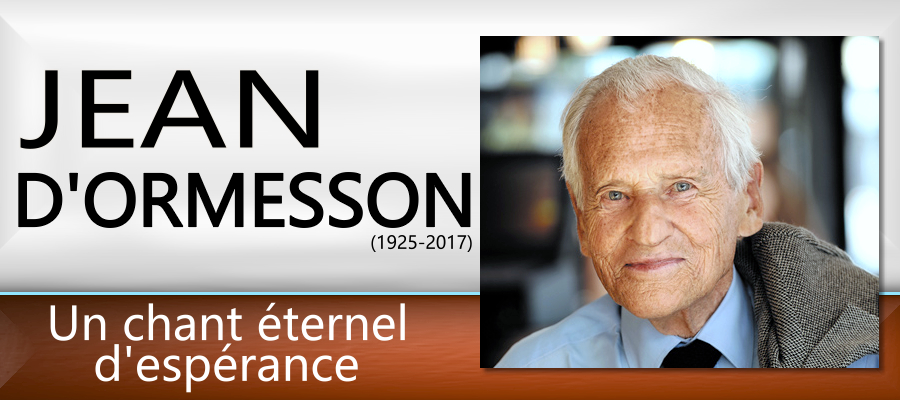
Je change.
Comme l’univers, la vie, le temps, je change et je reste le même. »

« Ne vous laissez pas abuser. Souvenez-vous de vous méfier. Et même de l’évidence : elle passe son temps à changer. Ne mettez trop haut ni les gens ni les choses. Ne les mettez pas trop bas. Non, ne les mettez pas trop bas. Montez. Renoncez à la haine, elle fait plus de mal à ceux qui l’éprouvent qu’à ceux qui en sont l’objet. Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie aussi est une sagesse. Et la sagesse, une folie. Fuyez les préceptes et les donneurs de leçons. Jetez ce livre. Faites ce que vous voulez. Et ce que vous pouvez. Pleurez quand il le faut. Riez. J’ai beaucoup ri. J’ai ri du monde et des autres et de moi. Rien n’est très important. Tout est tragique. Tout ce que nous aimons mourra. Et je mourrai moi aussi. La vie est belle.
« Si quelque chose a marqué mon enfance, c’est l’amour. Un amour calme, sans tempête, sans fureur. Mais un amour fort. L’amour durable des parents entre eux. L’amour exigeant des parents pour leurs enfants. L’amour, mêlé de respect, des enfants pour les parents (…).
J’aimais beaucoup lire. Ou faire semblant de lire.
A la différence du théâtre ou du cinéma qui vous imposent leur rythme, il y a un style de lecture très proche de la rêverie.
N’allez pas croire qu’il s’agisse de paresse. C’est à peu près l’opposé. Au lieu de lire bêtement, à la suite, le livre qui vous est proposé, vous vous arrêtez, au contraire, à chaque ligne pour ajouter au texte quelque chose de votre cru. Pour enrichir l’extérieur d’un apport intérieur. Pour y mêler vos sentiments et votre propre expérience. Pour vous approprier l’œuvre étrangère qui vous est proposée (…).
J’aime rêver. La science ne rêve pas. Mais ce qu’elle découvre est la plus formidable de toutes les manières de rêver. Plus que les livres, plus que les tableaux et les monuments, plus que les paysages, plus peut-être que l’amour. J’ai rêvé le monde et la science qui tente de le comprendre. (…)
Je ne suis ni savant ni poète. J’aime les histoires. La plus belle histoire du monde, c’est l’histoire de ce monde qui n’existe que parce que nous le rêvons.
Il y a quelque chose de mieux que de s’agiter : c’est de s’ennuyer. J’écrirais volontiers un éloge de la paresse et de l’ennui. L’ennui est cet état béni où l’esprit désoccupé aspire à faire sortir du néant quelque chose d’informe et déjà d’idéal qui n’existe pas encore. L’ennui est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Voyager n’est pas mal. Le succès, c’est très bien. Etre heureux, qui ne le souhaite? S’ennuyer est bien mieux. C’est quand vous êtes perdu que vous commencez à être sauvé. La vie la plus banale, allumer un feu dans une cheminée, se promener dans les bois, ronger son frein et son cœur parce qu’on n’est bon à rien, maudire le monde autour de soi, s’abandonner aux songes, ou, mieux encore ne rien faire du tout, ou, en tout cas le moins possible – avant, bien sûr de se jeter dans le travail à corps perdu -, peut mener autrement loin (…).
J’aime les départs, les ruptures, les descentes vers le soleil, l’attente de ce qui va se passer. Je déteste les liens, les responsabilités, la vie sociale, les carrières. Dans ce train, j’étais très libre parce que j’étais déjà parti et que je n’étais pas encore arrivé. J’allais vers des espérances qui n’étaient pas précisées : elles étaient immenses puisqu’elles n’étaient pas limitées.
« L’homme est plus puissant que jamais Tout va mal : il l’est devenu beaucoup trop. Hier, il n’avait pas de moyens, mais il avait des espérances. Aujourd’hui, il a des moyens. Mais il n’a plus d’espérance. Il n’a plus d’espérance parce que les grandes choses auxquelles il croyait se sont écroulées tour à tour. Les vieilles vertus d’autrefois – le respect pour les anciens, la tradition, la famille, l’exaltation du travail, la patrie – sont tombées au rang de sarcasmes, de matières à plaisanterie, de lubies malfaisantes. Compromises par leurs liens avec des causes impures ou vaincues, avec des intérêts camouflés, avec des idéologies rejetées, elles ont cessé de constituer ce qu’elles avaient été si longtemps : un moteur de l’histoire (…).
L’argent tombe sur le monde, comme une vérole sur le pauvre peuple, bien après la pensée, bien après l’émotion, le cri, le rire, la parole, et après l’écriture. Maintenant qu’il est là, et bien là, il est difficile de s’en passer. Sa suppression entraînerait des souffrances plus grandes que ses excès. Qu’on le veuille ou non, il est devenu une espèce de malédiction âprement recherchée. Poussons le bouchon un peu loin : il est la forme prise par le mal pour se faire adorer. L’argent, écrit Cioran, a ruiné le monde. Pendant des milliards d’années, il n’y a pas de mal dans l’univers. Le mal naît avec la pensée. Il prospère avec l’argent.
En face de l’argent, qu’y a-t-il ? Il y a ceux qui n’en ont pas. On dirait que le monde moderne est fait d’argent et de pauvres. L’argent coule à flots : sur les palais des congrès, sur les aéroports, sur les avions, sur les trains à grande vitesse, sur les autoroutes et leurs échangeurs, sur les porte-avions et sur les sous-marins, sur les centrales nucléaires, sur les usines, sur les laboratoires, sur les hôpitaux qui manquent pourtant cruellement de ressources. Il ne coule pas sur les pauvres (…).
« L’histoire devient une espèce de kaleidoscope en délire où ne cessent de se succéder, et de plus en plus vite, des images éblouissantes et dépourvues de sens. Les frontières éclatent.Les distinctions s’effacent. Chacun est lié aux autres par les ondes et la toile. La campagne disparaît peu à peu. Les villes s’étendent et se rejoignent.
Il n’y a d’histoire que de la folie des hommes. L’ordre se met de lui-même autour des choses – mais le désordre aussi. Les peuples et les Etats oscillent entre la paix et la guerre, entre la liberté et la servitude, entre l’ordre et le désordre. Ils se fatiguent vite, même du bonheur qui ne tarde jamais à se teinter de lassitude. A peine jouissent-ils des bienfaits d’un gouvernement sage et juste qu’ils réclament plus de sagesse et une autre justice (…).

Tout passe. Tout finit. Tout disparaît.
Et moi qui m’imaginais devoir vivre pour toujours, qu’est-ce que je deviens ?
Il n’est pas impossible…
Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu
est une vérité et une beauté pour toujours
et la mort elle-même ne peut rien contre moi. »
